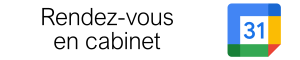Dans un monde professionnel obsédé par les données, les KPI (Key Performance Indicators) et les tableaux de bord, une loi économique méconnue explique pourquoi tant d’équipes performantes se sentent soudainement stressées, désengagées et cyniques. Il s’agit de la loi de Goodhart, un principe qui montre comment la poursuite d’un chiffre peut détruire la mission même qu’il est censé mesurer, avec des conséquences directes sur le bien-être au travail et les risques psychosociaux.
Qu’est-ce que la loi de Goodhart ? Définition et origine
La loi de Goodhart est un principe économique et social qui décrit un piège courant dans l’utilisation des indicateurs de performance. Sa formulation la plus célèbre est la suivante :
« Quand une mesure devient un objectif, elle cesse d’être une bonne mesure. »
En d’autres termes, dès que l’on commence à évaluer et récompenser les gens sur la base d’un indicateur statistique précis, ceux-ci vont concentrer leurs efforts pour optimiser cet indicateur, souvent au détriment de l’objectif réel ou global que la mesure était censée représenter.
Ce décalage entre le travail réel et le travail mesuré est une source majeure de stress professionnel et de risques psychosociaux. Les employés ne sont plus incités à bien faire leur travail, mais à faire en sorte que le chiffre soit bon. Cette pression pour « jouer avec le système » vide le travail de son sens, favorise le désengagement et a une influence directe et néfaste sur la Qualité de Vie au Travail (QVT).
Origine et formulation de Charles Goodhart
Auteur : Elle a été formulée par l’économiste britannique Charles Goodhart en 1975.
Contexte initial : Goodhart l’a d’abord appliquée à la politique monétaire. Il observait que si une banque centrale tentait de réguler l’économie en ciblant un indicateur comme la masse monétaire, les banques et les investisseurs adapteraient leur comportement pour contourner cette règle, rendant l’indicateur inutile.
Formulation originale (plus technique) : « Toute régularité statistique observée tendra à s’effondrer dès lors qu’une pression sera exercée sur elle à des fins de contrôle. »
Bien que née dans le contexte économique, cette loi s’applique parfaitement au management moderne et explique de nombreux dysfonctionnements organisationnels qui mènent au burn-out et à la détérioration du climat social en entreprise.
L’Effet Cobra : L’exemple historique qui illustre le piège des indicateurs
L’exemple le plus célèbre illustrant ce concept est « l’effet cobra », antérieur à la loi elle-même. Cette anecdote historique démontre de manière frappante comment un indicateur mal conçu peut produire l’effet inverse de celui recherché.
Le problème : À l’époque de l’Inde coloniale britannique, la ville de Delhi était infestée de cobras venimeux, représentant un danger pour la population.
La mesure (devenue objectif) : Le gouvernement colonial a mis en place une prime financière pour chaque cobra mort rapporté aux autorités.
Le résultat (pervers) : Au début, la mesure a fonctionné et le nombre de cobras diminua. Mais rapidement, des citoyens entreprenants ont compris qu’ils pouvaient tirer profit du système. Ils ont commencé à élever des cobras dans le seul but de les tuer et de toucher la prime.
La conséquence : Lorsque le gouvernement s’en est rendu compte et a supprimé la prime, les éleveurs ont relâché tous leurs cobras devenus sans valeur marchande. La population de cobras à Delhi était finalement plus importante qu’auparavant. L’objectif (la prime par cobra) avait totalement remplacé le but réel (réduire le nombre de cobras et protéger la population).
Cet effet cobra se reproduit quotidiennement dans nos organisations modernes, sous des formes moins spectaculaires mais tout aussi contre-productives.
La loi de Goodhart en entreprise : Impact sur le stress et la QVT
C’est dans le management quotidien et la gestion des ressources humaines que la loi de Goodhart a les effets les plus délétères sur la QVT et l’engagement des collaborateurs. Les indicateurs, conçus pour aider au pilotage, deviennent des sources de pression absurde et de souffrance au travail.
Service client : La pression du nombre de tickets
Le KPI problématique : Si les agents sont évalués uniquement sur le « nombre de tickets traités par heure » ou le « temps de résolution moyen », ils seront incités à clore les demandes le plus vite possible, quitte à mal répondre au client, à donner des solutions superficielles ou à transférer le problème vers un autre service.
Impact QVT et stress : L’employé subit un stress intense lié à la pression chronométrique, tout en sachant qu’il ne satisfait pas réellement le client. La QVT s’érode car la fierté du travail bien fait est remplacée par la frustration de devoir « bâcler » pour atteindre un quota. Cette dissonance cognitive entre les valeurs professionnelles et les comportements imposés est un facteur majeur de risques psychosociaux et peut mener au burn-out.
L’effet cobra : Les agents développent des stratégies d’évitement (ne pas répondre aux demandes complexes), de transfert abusif, ou de clôture prématurée des tickets. Le service client se dégrade, les réclamations augmentent, créant encore plus de tickets à traiter dans un cercle vicieux.
Développement logiciel : Les tests inutiles
Le KPI problématique : Si une équipe de développeurs est évaluée sur le « pourcentage de couverture de code par les tests automatisés », les développeurs pourraient écrire des tests inutiles qui « cochent la case » de l’indicateur, mais ne vérifient pas réellement la qualité, la robustesse ou la sécurité du logiciel.
Impact QVT et stress : L’équipe atteint l’objectif chiffré, mais le produit reste fragile. Cela crée une « dette technique » invisible et un stress futur lors des pannes inévitables. Le sens du métier (créer un produit fonctionnel et fiable) est perdu, remplacé par une course au pourcentage. Les développeurs perdent leur motivation intrinsèque et leur engagement professionnel.
L’effet cobra : Les tests deviennent une formalité bureaucratique plutôt qu’un outil de qualité. Les bugs passent à travers, les incidents en production se multiplient, et l’équipe passe plus de temps à éteindre des incendies qu’à innover.
Ventes : Le piège des objectifs à court terme
Le KPI problématique : Des objectifs basés uniquement sur le « nombre de nouveaux contrats signés » ou le « chiffre d’affaires mensuel » peuvent pousser les commerciaux à vendre des produits inadaptés aux besoins réels des clients, à survendre des promesses intenables, ou à privilégier les ventes rapides au détriment de la relation client durable.
Impact QVT et stress : La pression du chiffre à court terme crée un environnement de travail toxique et stressant. La QVT est remplacée par l’anxiété permanente d’atteindre le quota, quel qu’en soit le coût pour la réputation de l’entreprise, la satisfaction client ou l’éthique professionnelle. Cette culture du résultat immédiat génère une compétition malsaine entre collègues et détruit la cohésion d’équipe.
L’effet cobra : Les clients insatisfaits génèrent des résiliations en cascade, une mauvaise réputation de l’entreprise, et une perte de confiance. Le coût d’acquisition client augmente tandis que la fidélisation s’effondre. À long terme, le chiffre d’affaires décline malgré les efforts frénétiques des commerciaux.
Loi de Goodhart dans le service public : Éducation et police
Le secteur public n’est pas épargné par ce phénomène. L’importation de la « culture du résultat » et du management par objectifs dans la fonction publique y génère les mêmes effets pervers, avec des conséquences sur la santé mentale au travail des agents.
Éducation : Le bachotage généralisé
Le KPI problématique : Si les enseignants sont évalués principalement sur le « taux de réussite de leurs élèves » à un examen standardisé, ils pourraient être tentés de « bachoter » (enseigner uniquement pour réussir l’examen) plutôt que de développer la compréhension profonde, la pensée critique ou la curiosité intellectuelle des élèves.
Impact : Le stress est transféré aux élèves ET aux enseignants, dont la mission éducative fondamentale est dévoyée. Les enseignants perdent le sens de leur vocation, développent un sentiment d’imposture et subissent une pression évaluative constante. Les élèves apprennent à mémoriser sans comprendre.
L’effet cobra : Le niveau réel baisse tandis que les résultats artificiels augmentent. Les diplômes se dévaluent, et la société dans son ensemble en paie le prix à long terme.
Police : La statistique avant la sécurité
Le KPI problématique : Si les services de police sont évalués sur le « nombre d’arrestations » ou le « taux d’élucidation », ils pourraient se concentrer sur des délits mineurs faciles à constater (stationnement, petite délinquance) plutôt que de s’attaquer à la criminalité organisée ou complexe qui demande plus de temps et de ressources.
Impact QVT : Cela démotive profondément les agents qui sentent que leur travail est évalué de manière superficielle et que leur expertise n’est pas valorisée. Le sentiment d’utilité sociale diminue, facteur essentiel de bien-être au travail dans les métiers de service public.
L’effet cobra : La criminalité grave n’est pas traitée efficacement, le sentiment d’insécurité augmente, tandis que les statistiques officielles peuvent sembler bonnes.
5 Solutions pour éviter le piège de Goodhart et protéger la QVT
La loi de Goodhart nous avertit que les indicateurs de performance sont des outils de pilotage, pas des buts en soi. Abuser des chiffres mène à la bureaucratie, au stress chronique et à des comportements contre-productifs. Pour atténuer cet effet et protéger la santé mentale au travail, voici cinq stratégies éprouvées.
1. Multiplier les indicateurs de performance
Principe : Ne jamais utiliser un seul indicateur. Croiser plusieurs mesures complémentaires et parfois contradictoires pour avoir une vision équilibrée de la performance.
Exemple concret : Pour un service client, mesurer simultanément :
- La quantité (nombre de tickets traités)
- La qualité (score de satisfaction client)
- La durabilité (taux de tickets non réouverts)
- Le bien-être (niveau de stress auto-déclaré des agents)
Bénéfice QVT : Cette approche réduit la pression unilatérale sur un seul chiffre et reconnaît la complexité du travail réel. Les collaborateurs se sentent évalués de manière plus juste et complète.
2. Rotation des KPI et adaptation
Principe : Un bon indicateur s’use vite, car les gens apprennent rapidement à l’optimiser. Il faut donc faire évoluer régulièrement les métriques utilisées et les adapter aux contextes changeants.
Exemple concret : Alterner entre des KPI de qualité (satisfaction), de vitesse (délai de réponse), d’innovation (nouvelles solutions proposées) et de collaboration (aide aux collègues).
Bénéfice QVT : Cette variabilité empêche l’installation de stratégies de contournement et maintient l’attention sur le travail réel plutôt que sur l’optimisation d’un seul chiffre. Elle réduit aussi la monotonie et stimule l’engagement.
3. Management participatif et co-construction
Principe : Impliquer les personnes qui « font le travail » dans la définition des indicateurs les plus pertinents. Cette démarche participative est un levier majeur de QVT et de prévention des risques psychosociaux.
Exemple concret : Organiser des ateliers où les équipes proposent elles-mêmes les métriques qui reflètent le mieux la valeur de leur travail, puis valider collectivement ces choix.
Bénéfice QVT : Cette approche redonne du sens et du contrôle (autonomie) aux employés sur leur propre évaluation. L’autonomie est l’un des trois piliers fondamentaux de la motivation intrinsèque et du bien-être au travail. Les collaborateurs se sentent écoutés, respectés et parties prenantes du système plutôt que victimes d’un contrôle arbitraire.
4. Maintenir le sens et la vision stratégique
Principe : Toujours rattacher explicitement chaque mesure à l’objectif final et stratégique de l’organisation. Rappeler régulièrement le « pourquoi » derrière le « combien ».
Exemple concret : Dans les réunions d’équipe, commencer par rappeler la mission (ex: « Nous aidons nos clients à résoudre leurs problèmes ») avant de parler des chiffres. Raconter des histoires de réussite client plutôt que de se focaliser uniquement sur les statistiques.
Bénéfice QVT : Cette connexion au sens donne une perspective plus large et évite que le travail ne se réduise à une course aux chiffres. Le sens au travail est un facteur protecteur majeur contre le burn-out et un moteur puissant d’engagement professionnel.
5. Privilégier le jugement humain sur les données
Principe : Ne pas laisser un tableau de bord remplacer l’analyse qualitative, le contexte et le bon sens. Un bon manager doit savoir quand et pourquoi le chiffre ment ou ne raconte qu’une partie de l’histoire.
Exemple concret : Lors des évaluations, prendre le temps d’échanger qualitativement avec les collaborateurs sur leurs réalisations, leurs difficultés et leur ressenti, plutôt que de se limiter à un score quantitatif automatisé.
Bénéfice QVT : Cette reconnaissance du contexte, de l’effort qualitatif et des situations particulières est essentielle pour réduire le stress et valoriser réellement le travail effectué. Les employés se sentent considérés comme des êtres humains et non comme des machines à produire des statistiques.
Conclusion : Remettre les KPI à leur juste place pour une performance durable
La loi de Goodhart n’est pas une critique de la mesure ou des indicateurs de performance en soi, mais un avertissement salutaire contre leur idolâtrie et leur utilisation abusive. Les KPI sont des outils précieux quand ils sont utilisés avec intelligence, nuance et dans le respect du travail réel.
En oubliant le « pourquoi » au profit du « combien », en transformant les moyens en fins, les organisations créent des environnements de travail absurdes, démotivants et générateurs de souffrance. Cette obsession du chiffre alimente les risques psychosociaux, le désengagement des collaborateurs et in fine, la sous-performance organisationnelle.
Restaurer la Qualité de Vie au Travail et construire une performance durable exige de remettre les chiffres à leur juste place : celle d’outils au service de l’intelligence humaine, du sens et de la mission collective, et non l’inverse. Un management bienveillant et efficace sait articuler mesure objective et jugement qualitatif, contrôle et confiance, résultats et bien-être.
Comme le résume parfaitement la loi de Goodhart : quand la mesure devient l’objectif, nous perdons de vue ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, c’est la capacité des organisations à créer de la valeur durablement, tout en préservant la santé et l’épanouissement des femmes et des hommes qui les composent.